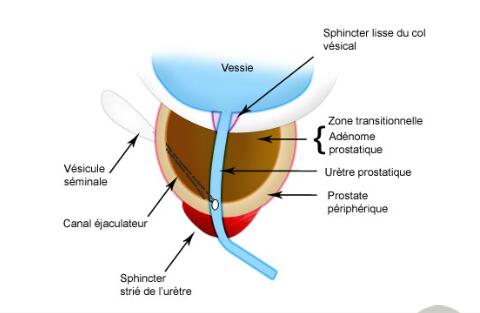Le pays Bamiléké qui recouvre les plateaux du centre-ouest du Cameroun, est habité par une population dense, et se compose d’une centaine de chefferies, chacune bien délimitées par des frontières. Dans l’une d’entre elles, appelée Bangwa, j’ai mené une enquête ethnographique sur le système de parenté patrilinéaire. Cette recherche m’a conduit à m’intéresser aux rites relatifs à la naissance des enfants et à les analyser à la lumière du système symbolique qui les sous-tend. En présentant ce travail, je voudrais aussi montrer que l’on peut faire abstraction des comportements pour situer les relations parents-enfants, et préciser l’ordre sur lequel ces relations s’appuient.
Les Bangwa pensaient autrefois que les enfants à naître vivaient dans les marigots sous forme de crapaud, ou de lombric noir quand ils étaient de futurs fils de chef. Lorsqu’une femme tuait un de ces animaux par mégarde avec sa houe, elle se lamentait et portait sur ses reins des feuilles sèches de bananier plantain en signe de deuil afin d’éviter qu’elle-même ou une de ses voisines n’accouche d’un enfant mort-né. Les anciens racontent que ces créatures sortaient de l’eau la nuit, et allaient deux par deux, suivant les chemins, visiter les cases d’habitation. Lorsqu’ils rencontraient un homme et une femme qui s’entendaient bien et communiquait la paix autour d’eux, ils entraient ensemble dans la case; mais un seul y pénétrait lorsque le couple n’avait pas ces qualités exceptionnelles. Neuf mois après, la femme ainsi visitée mettait au monde dans le premier cas des jumeaux, signe de paix et de prospérité, et dans le second un enfant unique.
Avant de naître, les enfants vivent sous forme de double dans l’eau des rivières qui est par excellence le lieu d’origine de la vie. Les grandes familles nobles résident d’ailleurs toujours en bas des vallons à proximité des marigots, car la terre y est plus fertile et les femmes n’ont pas une trop longue distance à parcourir pour aller y puiser de l’eau. Les petites familles de serviteurs habitent au contraire en haut des pentes sur des terres plus sèches et moins riches. Enfin, les Bangwa rejettent sur le sommet des collines ce qui est jugé mauvais et néfaste pour la société, afin que le feu de brousse le brûle pendant la saison sèche. Les mauvais morts par exemple, qui ne pouvaient pas bénéficier d’une sépulture normale à cause de leur ventre gonflé d’ascite, étaient abandonnés sur les hauteurs. Les habitations construites sur le flanc des vallons sont ainsi situées entre le haut associé au feu et à la mort, et le bas où coule l’eau source de vie. Ces catégories bien marquées se retrouvent dans les paroles et les gestes quotidiens. Au cours des salutations usuelles, les Bangwa se demandent mutuellement : tchfô’ rhul « est-ce que ça va? » ou plus exactement, « est-ce que les nouvelles sont humides, fraîches? ». Quand cela ne va pas, ils disent: ira ndep, « c’est chaud », tout ce qui est déplaisant fait référence au sec. Mba’a jiïp même, « ne me fait pas sécher» équivaut pour nous à « ne me fait pas ch…«. En guise de bénédiction, un père crache sur la poitrine de son fils ou de son descendant venu lui rendre visite, pour maudir il lui souffle de la cendre sur le visage. Recevoir de la cendre est encore actuellement la malédiction la plus redoutée dans le pays.
L’eau, le froid et l’humide sont bénéfiques, tandis que le feu, le chaud et le sec sont maléfiques. Mais ces éléments et leurs attributions ne sont pas irrémédiablement anti-nomiques. C’est ce qu’attestent les expressions qui se rapportent au mariage. Lorsqu’une femme est mariée, les Bangwa disent : jii nang ndiie, « elle cuit (dans) la maison », c’est-à-dire qu’elle fait la cuisine pour son mari et que, ce faisant, elle renverse l’ordre topographique qui tient à distance l’eau et le feu en un ordre domestique où ces éléments sont rapprochés et neutralisés par une inversion (feu du foyer en bas et eau de la marmite en haut). Mais le verge mbi nang, « cuire », dénote aussi la relation sexuelle. Les adolescents aiment à poser à de nouveaux interlocuteurs cette devinette: « qu’est-ce qu’une goutte d’eau qui devient poisson?… ». On dit au jeune qui a engrossé une fille: «puisque tu as versé l’eau, bois-la», c’est-à-dire marie-toi. Quand une femme fait une fausse couche, on dit à son mari : « tu t’es débarrassé de l’eau, mais tu as gardé la calebasse ». L’eau évoque la sexualité et plus précisément celle de l’homme. Le liquide spermatique est appelé d’ailleurs l’eau de l’homme. Par contre la vie affective et la sexualité féminine sont symbolisées par le feu. « II n’y a pas de fumée sans feu » signifie qu’il n’y a pas d’enfants sans femme ou sans alliance. «Une bonne épouse», c’est-à-dire une femme qui fait bien la cuisine et qui a de nombreux enfants, « est un bon feu ». Quand un homme a perdu beaucoup d’enfants et qu’une de ses épouses est enceinte, on dit: « le feu l’a brûlé, mais il se chauffe encore». Les femmes infidèles sont comparées à de la braise qui brûle ceux qui viennent s’y chauffer.
Le rapport sexuel est une cuisson et les enfants qui en résultent, sont assimilés à de la «bonne nourriture». «Les enfants», dit le proverbe, «sont la nourriture que Dieu donne et que l’on mange». Aussi les femmes qui venaient d’accoucher, ne devaient-elles pas toucher de leurs mains nues les aliments qu’on leur tendait, car elles devaient se consacrer à une seule nourriture, l’enfant. Elles étaient autorisées à se resservir de leurs mains par la mère de leur mère, trois semaines après l’accouchement, et elles reprenaient leur activité culinaire après la célébration d’une petite cérémonie appelée kelôngtôngnguo, «plantain du cordon ombilical de l’enfant». Lorsqu’une femme avait accouché, la co-épouse ou la voisine qui avait joué le rôle de sage-femme enterrait profondément le placenta au pied d’un bananier plantain sur le point de mûrir, et elle plantait, dans le tronc, le morceau de bambou raphia qui avait servi à couper le cordon ombilical du nouveau-né. Les membres de la famille savaient ainsi qu’il ne fallait pas toucher à ses bananes. Quand le reste du cordon ombilical se détachait par dessèchement du ventre de l’enfant, la mère l’enveloppait dans une feuille de bananier plantain et le rangeait sous son lit. Un mois après la naissance, les co-épouses, les sœurs, les voisines envahissaient, un soir à la tombée de la nuit, la case de l’accouchée. La première épouse ou à défaut une sœur du mari, creusait de son plantoir, au pied du lit, un trou où elle déposait le petit bout de cordon ombilical. La mère se lavait le visage au-dessus, la première épouse faisait de même. Puis celle-ci prenait un morceau de bambou raphia dont elle fendait et refendait l’extrémité pour en faire une torche qu’elle allumait au feu. Elle frappait de la torche embrasée le trou et chacun des murs de la case, au milieu des hullulements joyeux de toutes les femmes présentes. Enfin, elle rebouchait le trou par terre.
La signification de ces gestes est la suivante: l’eau qui sert à laver la mère de toutes les mauvaises choses qu’elle porte en elle, tombe sur le sol, et le feu qui chasse les mauvais esprits, provenant de l’extérieur, est projeté sur les quatre murs de la case, sa’ ndu-e, ou par homonymie sur les quatre points cardinaux sa’ ngguong. L’eau et le feu que ce rituel utilise pour leurs qualités bénéfiques, purification interne et destruction externe, sont replacés dans leurs positions cosmiques, en bas en en haut, à l’instant où l’enfant est relié par son cordon ombilical à la terre de son père. Il n’est donc pas possible d’utiliser ces éléments pour la cuisine dans leurs positions domestiques. Les bananes plantains qui avaient été mises de côté pour cette occasion n’étaient pas bouillies comme de coutume, mais grillées au feu et consommées avec de l’huile de palme et du sel offerts par le mari. Toutes les femmes présentes en mangeaient sauf la mère et ses enfants qui devenaient ainsi un sujet de plaisanterie pour les autres. « C’est dommage que vous ne puissiez pas goûter de ce plantain », leur disait-on, « il est vraiment délicieux ». La mère riait et répondait : « j’en mangerai bientôt et ce sera à votre tour de ne pas en manger ». L’enfant est naturellement bien plus important que la nourriture. De plus si la mère avait mangé une banane de ce régime mûri en contigûité avec le placenta, c’eut été comme si elle avait mangé une partie d’elle-même ou de l’enfant. Bien que celui-ci fût une bonne nourriture, il n’était pas pour autant comestible. Tel était ce que les femmes soulignaient en plaisantant à la nouvelle mère. A partir du moment où le nouveau-né était relié à un troisième élément, la terre, mitoyenne entre le haut et le bas, il entrait dans le plan cosmique sans pour autant quitter le plan domestique, il n’était plus seulement mangeable, il devenait mangeur.
Il ressort de ces rites que la naissance n’est pas ici un événement neuf ouvrant un avenir, elle n’apporte rien qui ne soit déjà là. Dès qu’un enfant Bangwa voyait le jour, il était pris dans un système symbolique préexistant et fortement enraciné dans divers aspects de l’organisation sociale tels que le haut et le bas, le sec et l’humide, l’interne et l’externe. Cette symbolisation s’organise autour d’une métaphore (la cuisson) évoquant l’alliance parentale, et d’une métonymie exprimant la filiation paternelle puisque le nouveau né est rattaché à la terre de son père par une partie de lui-même. L’enfant est ainsi relié à l’ordre parental par l’intermédiaire des deux pôles du langage. Cette corrélation entre les deux axes de la parenté, alliance et filiation, et les axes paradigmatique et syntagmatique dont relèvent la métaphore et la métonymie, n’est pas absolue puisqu’entre ces deux figures l’enfant a aussi le statut ambivalent de nourriture non mangeable. Cette corrélation indique néanmoins que l’assise sur laquelle repose les rites de naissance, n’est autre que la structure du langage. La fonction de ces rites est donc de confirmer l’insertion parentale et sociale du nouveau-né en l’insérant dans un ordre langagier. En effet, quand un enfant mourait avant la cérémonie kelôngtôngnguo, les Bangwa ne le lamentaient pas et l’enterraient dans le haut de l’allée centrale qui conduit à leur résidence. Ils remettaient ainsi l’enfant dans un endroit où il était entré dans la concession. Autrement dit tant que l’enfant n’était pas intégré symboliquement à la société, il était assimilable aux êtres imaginaires qui hantaient les marigots. Il n’était pas encore considéré comme un être humain.
Charles-Henri PRADELLES de LATOUR DEJEAN Attaché de Recherches au CNRS.